Cyber Résilience : les fondamentaux, la progression et l’évaluation de maturité
La cyber résilience regroupe l’ensemble des capacités d’une organisation à résister aux cyberattaques, à maintenir ses activités et à retrouver un fonctionnement normal après un incident. Tersedia, en tant qu’expert Infrastructure Cyber Resilience et fournisseur de services Cloud certifié ISO 27001 et HDS avons identifié les thèmes clés fondamentaux de la cyber résilience.
Les fondamentaux pour une première approche de la cyber résilience (2ème partie)
Sécuriser les Endpoints et l’infrastructure interne
Les terminaux utilisateurs et serveurs constituent la dernière ligne de défense. Un programme malveillant qui s’exécute sur une machine non protégée peut provoquer des dégâts majeurs (chiffrement ransomware, vol de données, etc.). Il est donc indispensable de protéger chaque endpoint et de maintenir une hygiène informatique rigoureuse. Pour cela :
Appliquez un processus de gestion des vulnérabilités et des patchs pour corriger rapidement les failles de sécurité connues. De nombreuses attaques exploitent des logiciels non mis à jour ; un bon patch management réduit votre surface d’attaque jour après jour. Automatisez les mises à jour dans la mesure du possible et surveillez les annonces de failles critiques (certaines solutions peuvent remonter automatiquement les correctifs disponibles via une plateforme centralisée).
Antivirus/antimalware de nouvelle génération, EDR (Endpoint Detection & Response) ou XDR. Ces outils analysent les comportements système et peuvent stopper des malwares, voire détecter des signaux faibles d’intrusion. Par exemple, un EDR français comme celui utilisé par Tersedia surveille en continu les processus et peut isoler automatiquement un poste suspect dès les premiers signes de ransomware, évitant la propagation. Assurez-vous que ces agents de sécurité sont installés sur tous les terminaux (ordinateurs, serveurs, VM cloud) et tenus à jour.
Comme évoqué via Zero Trust, il convient d’isoler les postes utilisateurs du réseau des serveurs sensibles, d’isoler les environnements de développement, de séparer le réseau industriel/OT du réseau IT, etc. Utilisez pour cela des firewalls internes ou VLAN avec filtrage. Des solutions de firewalling de nouvelle génération (pare-feu NGFW) ou de cloisonnement sont capables d’appliquer des règles très fines entre segments et de détecter les comportements anormaux sur le réseau (ex. Stormshield, Fortinet, etc., sans les citer, offrent ce type de fonctionnalité pour renforcer la résilience du réseau).
N’oublions pas l’infrastructure matérielle. Protégez l’accès physique à vos locaux informatiques (salles serveurs, datacenters) pour éviter qu’un intrus ne compromette directement vos équipements. Par ailleurs, prévoyez de la redondance matérielle sur les composants critiques de votre infrastructure : alimentation sans coupure (UPS), générateurs, doubles liens réseau, clusters de serveurs ou hyperviseurs redondants, stockage en miroir, etc. Cette redondance limite l’impact des pannes matérielles ou incidents locaux et participe à la résilience globale. Par exemple, Tersedia héberge les données de ses clients sur des stockages distribués robustes (type objets multi-sites) afin qu’une panne de nœud ou même de site n’interrompe pas le service. De telles dispositions, combinées à un Plan de Continuité Informatique (PCI), assurent que votre activité peut se poursuivre même en cas de sinistre localisé.
En résumé, chaque composant du SI doit être sécurisé et supervisé : un attaquant cherchant à progresser à l’intérieur du réseau se heurtera ainsi à plusieurs couches de défense (antivirus/EDR sur les postes, segmentation réseau, journaux d’accès, etc.). C’est l’application concrète de la défense en profondeur.
N’oubliez pas ces fondamentaux :

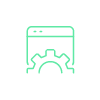
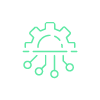

Maîtriser les accès
Mettre à jour
Segmenter
Surveiller
Sauvegarder les données et préparer la continuité d’activité
Aucune défense n’étant infaillible, la capacité de récupération après un incident est un pilier majeur de la cyber résilience. Cela passe par des sauvegardes robustes, isolées et testées ainsi qu’une anticipation de la continuité d’activité. Nos experts insistent particulièrement sur la sauvegarde, car en cas d’attaque de type ransomware, votre ultime rempart sera de restaurer vos données saines.
Adoptez une stratégie de sauvegarde éprouvée, telle que la règle 3-2-1-1-0 plébiscitée aujourd’hui.
3
2
1
1
0
Copies de vos données (production + 2 sauvegardes)
Types de supports différents
Copie stockée hors site (site distant ou cloud)
Copie hors ligne (isolée, non connectée en permanence, par ex. sur bande ou stockage déconnecté)
Erreur lors des restaurations. Cette dernière exigence de “0 erreur” implique de tester et vérifier régulièrement vos sauvegardes pour s’assurer qu’elles sont exploitables et restaurables rapidement
Respecter la règle 3-2-1-1-0 renforce la capacité à assurer la continuité d’activité sans perte majeure de données : en cas de sinistre ou de cyberattaque, vous pourrez récupérer une copie intacte de vos systèmes.
Concrètement :



Mettez en place des sauvegardes quotidiennes de vos données critiques, avec des rétentions suffisantes (gardez plusieurs versions dans le temps pour pouvoir revenir avant une éventuelle corruption).
Stockez au moins une copie sur un stockage non altérable (par exemple, un volume objet en mode immuable, ou des bandes WORM) afin de prévenir la suppression ou le chiffrement des backups par un attaquant. Les éditeurs spécialisés en sauvegarde proposent désormais des fonctionnalités d’immutabilité et de détection de ransomware intégrées – ce sont des atouts précieux pour la résilience (sans citer de noms, on pense aux solutions de sauvegarde moderne utilisées par Tersedia qui offrent ce niveau de protection).
Testez vos restaurations régulièrement, au moins sur un sous-ensemble : simulez une perte de serveur et mesurez le temps de restauration, vérifiez l’intégrité des données restaurées. Ces tests vous donneront confiance en votre plan et révéleront d’éventuels problèmes (sauvegarde incomplète, procédure trop longue) à corriger avant la vraie crise.
Par ailleurs, la sauvegarde n’est qu’un élément du Plan de Continuité d’Activité (PCA). Il convient d’élaborer un plan couvrant les scénarios d’incident majeur : comment remettre en service les applications critiques, sous quel délai (RTO) et avec quelle perte de données acceptable (RPO) ? Identifiez vos processus vitaux et définissez des procédures de reprise (procédures manuelles temporaires, bascule sur un site de secours, etc.). Pour la partie IT (Plan de continuité informatique: PCI), documentez clairement les étapes de reconstruction du SI à partir des sauvegardes, les personnes à contacter, l’ordre de remise en ligne des services, etc. Anticiper les risques cyber et préparer la gestion de crise sont essentiels pour assurer la pérennité de l’organisation. La sauvegarde en fait partie : appliquée correctement la règle 3-2-1-1-0 rend la reprise d’activité plus fluide et rapide grâce aux copies sur différents supports. En somme, investissez dans une infrastructure de sauvegarde résiliente et un plan de continuité c’est votre assurance vie numérique.
Vers une amélioration continue de la posture de sécurité
Enfin, il faut considérer la cyber résilience comme un processus continu. Les fondamentaux ci-dessus ne sont pas figés : ils doivent évoluer et s’améliorer en permanence face aux nouvelles menaces et changements de votre SI. Adoptez une démarche d’amélioration continue : mettez en place un cycle régulier de planification, mise en œuvre, vérification, amélioration (cycle PDCA).
Par exemple, après avoir implémenté les mesures de base, évaluez leur efficacité (via des audits internes, des tests d’intrusion, des exercices de restauration), puis comblez les écarts identifiés.
Il est recommandé de suivre des indicateurs (KPI) simples pour suivre votre posture : % de postes à jour, temps moyen de correction des vulnérabilités, taux de succès des sauvegardes/restaurations testées, nombre d’incidents détectés et traités, etc. Ces métriques vous permettront de mesurer les progrès et de justifier des efforts supplémentaires si nécessaire. Documentez les incidents ou “presque-incidents” rencontrés, et tirez-en des leçons (retours d’expérience). Chaque incident évité ou résolu doit aider à renforcer les procédures.
Ce principe d’amélioration continue est au cœur des normes comme l’ISO 27001, et constitue le lien naturel vers un niveau de maturité supérieur. Une fois les fondamentaux acquis, l’organisation peut chercher à aller plus loin : se conformer aux nouvelles obligations réglementaires, formaliser davantage ses processus, sensibiliser largement son personnel, etc. La seconde partie de ce guide aborde justement comment progresser vers une posture cyber résiliente plus mature, en bâtissant sur ces bases solides.



